L’affaire Chloroquine
Article reproduit avec l’aimable autorisation de l’auteur.
Par Claude ROCHET
29 mars 2020, mise à jour le 30 mars 2020
« Affaire », oui, car il ne s’agit pas – seulement – de classiques querelles d’égo entre médecins, d’antagonismes entre Paris et province. Mon précédent article m’a valu plusieurs appels et correspondances des plus intéressantes. Également quelques messages d’insultes ou de mépris, qui sont anecdotiques en soi, mais révèlent la posture des tenants du pouvoir qui détiennent la « vraie » science contre le peuple ignorant.
L’affaire chloroquine pose ainsi un débat de fond sur la nature de la science. Se prétendent du côté de la science tous ceux qui entendent en faire une source absolue de toute décision publique devant laquelle doit s’effacer toute préoccupation éthique. Qu’on en juge : au nom de la preuve dite scientifique, l’on prétend faire des essais cliniques sur des patients contaminés : ce qui veut dire que l’on va faire signer à ces patients une reconnaissance qu’ils acceptent ces essais sans savoir (le médecin non plus, l’essai se faisant en « double aveugle ») s’il reçoit un traitement ou pas. Un peu comme si, pour essayer un nouveau parachute, certains patients recevaient un parachute ne s’ouvrant pas.
Parmi les contributions intéressantes que j’ai reçues, un article de Jean-Dominique Michel – anthropologue suisse de la médecine – qui a fait un travail de fond de l’épistémologie de la science en médecine. Je reproduis plus bas une partie de son article Hydroxychloroquine : comment la mauvaise science est devenue une religion. Je n’avais jamais entendu parler de ce monsieur, et les petits Vichynski en culottes courtes pourront tirer un acte d’accusation définitif à mon encontre en voyant que, horresco referens !, il est référencé par des sites chrétiens. Un autre collègue, ancien titulaire de la chaire d’ingénierie des systèmes complexes à Polytechnique, a attiré mon attention sur l’ambiance scientiste régnant dans les enseignements de la médecine. Le scientisme est la volonté de donner tout pouvoir à une démarche dite scientifique pour traiter tous les problèmes concernant l’humanité. C’est un vieux débat en épistémologie né au XIXe siècle auquel Karl Popper avait apporté une conclusion en montrant que la science ne prouvait jamais rien, mais qu’elle pouvait prouver qu’une vérité était fausse, et donc progresser vers la formulation de nouvelles hypothèses plus justes. Je renvoie à ma page – ancienne – sur Karl Popper.
Le scientisme se manifeste en médecine par l’application généralisée de la méthode Evidence Based Medicine, ou « médecine basée sur les preuves ». J’ai eu de l’attirance au début pour cette approche née en 1980. Elle combinait l’approche théorique par consultation des données de la recherche, l’expérience empirique du praticien (par l’archivage systématique des compte-rendus d’intervention) et des données de contexte qui sont celles du patient. J’ai utilisé cette approche dans la conception des systèmes d’information où il s’agit de contrebalancer la science toute puissante des vendeurs de technologies par l’expérience empirique de l’utilisateur et les variables de contexte d’une organisation.
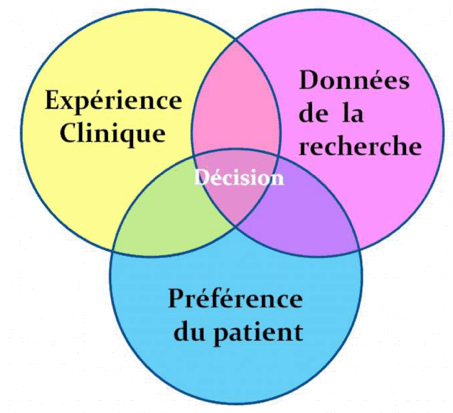
Le problème est que seule est restée la partie théorique. Et la traduction en français de « evidence » par « preuve » est trompeuse : evidence à, en anglais, un sens beaucoup plus large que preuves (qui a en français un sens d’irréfutabilité) et intègre l’ensemble des faits. L’EBM est de fait devenu l’outil du scientisme pour satisfaire aux prétentions scientifiques de l’idéologie dominante. Il n’est pas étonnant que, dans d’autres domaines que la médecine, des économistes totalitaires comme Cahuc et Zylberberg en fassent leur méthode de référence. Le ton de leur propos est une illustration des sous-jacents sur le non-débat sur la chloroquine et la méthode du professeur Raoult : « Notre approche est scientifique, ceux qui s’y opposent sont de dangereux » – le choix d’adjectifs est large, Cahuc et Zylberbeg emploient le terme de « révisionnistes » pour une allusion claire au crypto-nazisme. Dans la même veine, le professeur Raoult est traité de «déséquilibré mentalement» par des plumitifs comme Alain Duhamel qui n’ont aucune compétence en médecine, il se voit donner des leçons par le journaliste Patrick Cohen qui a une longue tradition de disqualification de tout opposant, ne serait-ce qu’en pensée, au système.
Le scientisme procède par démarche hypothético-déductive : l’on formule une hypothèse à partir d’une analyse théorique puis on cherche à la vérifier. Cette démarche est dite vérificationniste. Le problème est que si l’on procède ainsi les expériences seront biaisées, car l’on cherchera à vérifier l’hypothèse et, même inconsciemment, à écarter tout élément qui ne s’inscrirait pas dans cette logique. Il existe un biais de confirmation d’hypothèse, travers psycho-cognitif qui fait que tout individu cherche activement et accorde un poids plus grand aux preuves qui confirment ses hypothèses qu’à celles qui l’infirment. Karl Popper a au contraire une démarche scientifique sérieuse qui procède par réfutabilité : le but de la démarche scientifique est de pouvoir montrer qu’une hypothèse est fausse. Cet article de la revue médicale Nature Highlight negative results to improve science met l’accent sur la nécessité pour les revues scientifiques de publier les résultats négatifs qui sont porteurs d’enseignements. Le biais est que les recherches sont financées par les laboratoires (les revues scientifiques aussi) qui sont intéressés uniquement par les résultats positifs qui feront vendre.
Quand une hypothèse est réfutée (ou falsifiée, dans le langage de Popper), ce pas parce qu’elle contient une erreur, mais parce qu’elle correspond à un état de vérité qui ne permet plus de résoudre les problèmes. La vérité n’est jamais absolue, toute théorie doit potentiellement être réfutable et donner les moyens de sa réfutation. Est vraie une hypothèse qui résiste à la réfutation. C’est ce qui distingue la science de la pseudoscience. Dans l’affaire chloroquine, la pseudoscience est de prétendre que l’on n’a pas encore les preuves que le médicament est efficace. Au contraire, la démarche scientifique est de réfuter, à partir des résultats empiriques obtenus par le professeur Raoult, les bénéfices apportés par la chloroquine. L’on ne sait pas, à ce jour, si l’effet de la chloroquine contre le virus est vrai parce que l’on n’a pas démontré qu’il était faux. Les résultats sont encore empiriques, ce que confirme le Professeur Raoult, mais l’application du traitement, dans un contexte d’urgence, n’a pas démontré qu’il était faux.
Les scientistes, qui sont dans la pseudoscience, sont donc amenés à être violents et méprisants, car ils n’acceptent aucune contradiction. Ils rabaissent leurs contradicteurs en s’attaquant à leur personnalité, en les disqualifiant par des informations n’ont rien à voir avec le sujet. Les journalistes ont sorti de sa boîte un médecin généraliste des beaux quartiers de Paris qui n’a aucune compétence sur le sujet et qui a disqualifié Raoult en prétendant qu’il serait climato-sceptique. Le serait-il que cela n’a rien à voir avec le sujet et que c’est son droit le plus absolu. C’est une méthode totalitaire qui a permis à un charlatan comme Lyssenko de détruire la science agronomique soviétique en allant jusqu’à faire mourir son plus brillant représentant.
Je reproduis ci-dessous les passages de l’article de Jean-Dominique Michel.
Science et science et même : pas science !
Ce que le public ignore, lui qui fait un peu naïvement confiance aux «scientifiques», c’est que la recherche médicale est en crise systémique depuis plus de 15 ans. A l’époque, John Ioannidis, un médecin né à New York, passé ensuite par les Universités d’Athènes et Ioannina (Grèce) puis Harvard, avait lancé un sacré pavé dans la mare sous la forme d’un article intitulé « Why Most Published Research Findings Are False » (« Pourquoi la plupart des résultats de recherche scientifique publiés sont faux. ») Cet article eut un succès qui ne se démentit jamais, devenant même l’article technique le plus téléchargé en ligne de la revue PLoS (Public Library of Sciences) Medicine. Ioannidis a depuis rejoint la prestigieuse Université de Stanford, dans la Silicon Valley, où il exerce la fonction de directeur du Stanford Prevention Research Center tout en co-dirigeant le Meta-Research Innovation Center.
Pour reprendre le début de son article original, il disait en fait ceci : «L’on s’inquiète de plus en plus du fait que la plupart des résultats de recherche publiés actuellement sont faux. La probabilité qu’une affirmation de recherche soit vraie peut dépendre de la puissance et de la partialité de l’étude, du nombre d’autres études sur la même question et, surtout, du rapport entre les relations vraies et les relations fausses parmi les relations étudiées dans chaque domaine scientifique. »
L’article de Ioannidis fit l’effet d’un (petit) électrochoc. Ce qui n’était rien face aux répliques à venir…
Do you replicate ?
Dix ans plus tard, la société californienne Amgen (leader mondial de l’industrie des biotechnologies médicales) lança une montagne dans la mare en révélant avoir essayé de répliquer les résultats de 47 de 53 articles « phares » fondant les principaux protocoles alors utilisés contre le cancer. L’idée de la réplicabilité est simple et de bon sens : dans la démarche hypothético-déductive, l’on construit une hypothèse de recherche théorique, puis l’on définit un protocole d’expérimentation visant à la tester en vue d’obtenir des données qui en confirmeront ou en infirmeront la pertinence.
Pour en donner une métaphore charmante, le psychologue genevois Jean Piaget s’était intéressé, dans le cadre de son centre d’épistémologie génétique, à la manière dont les bébés acquièrent une compréhension du monde : observant que nos tout-petits opèrent d’une manière en fait très proche de la démarche empirique. Tous les parents ont pu par exemple observer que vers l’âge de 15-18 mois, tous les bébés s’engagent dans un curieux rituel répétitif en laissant tomber un objet (cuillère, tasse, ballon) au sol. Quand les parents ramassent l’objet et le redonnent au nourrisson, celui-ci recommence encore et encore d’une manière étonnamment déterminée.
Piaget a formulé l’hypothèse que le petit humain se livre en fait à une « expérience scientifique » en vérifiant un grand nombre de fois si le résultat est bien toujours le même. Il fait sens que si la tasse devait parfois tomber, parfois s’élever vers le plafond, la conclusion serait différente que dans le cas où le résultat est bien toujours le même. Par la reproduction des résultats, l’enfant acquiert une compréhension empirique de la loi universelle de la gravitation.
L’on comprend comment tout la fiabilité d’un résultat de recherche implique sa reproductibilité. Le « test » de Amgen, publié en 2016 dans le prestigieuse revue Science fit désordre : des 53 expériences reproduites, les chercheurs ne purent retrouver les mêmes résultats que pour… 7 d’entre elles !
Si, vous avez bien lu.
(…)
Tentatives de réaction
La communauté médicale a bien essayé de réagir, il faut le dire sans grand succès. En 2013, le Dr Richard Smith, rédacteur en chef du British Medical Journal, osa publier un éditorial sans ambiguité reprenant les critiques de Ioannidis : “ La plupart des études scientifiques sont erronées, et elles le sont parce que les scientifiques s’intéressent au financement et à leurs carrières plutôt qu’à la vérité.” Dans le même prestigieux journal, en 2014, il persistait : « La recherche médicale, toujours un scandale ».
En 2015, son collègue du Lancet, Richard Horton, publia une troublante confession dans un éditorial en ligne suite à une présentation gouvernementale au sujet de laquelle la plus stricte confidentialité avait été demandée au groupe sélectionné de participants :
« “Beaucoup de ce qui est publié est incorrect.” Je ne suis pas autorisé à dire qui a fait cette remarque car l’on nous a demandé de respecter les règles de Chatham House. L’on nous a également demandé de ne pas prendre de photos de diapositives. Ceux qui travaillaient pour des agences gouvernementales ont plaidé pour que leurs commentaires restent particulièrement non cités, puisque les prochaines élections britanniques signifient qu’ils vivent dans le « purdah » – un état glacial où de sévères restrictions à la liberté d’expression sont imposées à toute personne employée par le gouvernement. Pourquoi ce souci paranoïaque du secret et de la non-imputation ? Parce que ce symposium sur la reproductibilité et la fiabilité de la recherche biomédicale, qui s’est tenu au Wellcome Trust à Londres la semaine dernière, a abordé l’une des questions les plus sensibles de la science actuelle : l’idée que quelque chose a fondamentalement mal tourné avec l’une de nos plus grandes créations humaines.
Affligée par des études portant sur des échantillons de petite taille, des effets minuscules, des analyses exploratoires non valables et des conflits d’intérêts flottants, ainsi que par une obsession à poursuivre des tendances à la mode d’importance douteuse, la science a pris un virage vers l’obscurité. Comme l’a dit un participant, « les mauvaises méthodes donnent des mauvais résultats.” L’Académie des sciences médicales, le Conseil de la recherche médicale et le Conseil de la recherche en biotechnologie et en sciences biologiques ont désormais mis leur poids en termes de réputation au service d’une enquête sur ces pratiques de recherche douteuses. L’endémicité apparente des mauvais comportements en matière de recherche est alarmante.
Dans leur quête d’une histoire convaincante, les scientifiques sculptent trop souvent des données pour établir leur théorie préférée du monde. Ou bien ils remettent en cause des hypothèses pour fixer leurs données. Les rédacteurs en chef des revues scientifiques méritent eux aussi leur part de critiques. Nous aidons et encourageons les pires comportements. Notre acceptation du facteur d’impact alimente une compétition malsaine pour gagner une place dans quelques revues sélectionnées. Notre amour du significatif pollue la littérature avec de nombreux contes de fées statistiques. Nous rejetons les confirmations importantes. Les revues ne sont pas les seuls mécréants. Les universités sont dans une lutte perpétuelle pour l’argent et le talent, des finalités qui favorisent des mesures réductrices, comme la publication à fort impact. Les procédures d’évaluation nationales, telles que le cadre d’excellence pour la recherche, encouragent les mauvaises pratiques. Et les scientifiques, y compris leurs plus hauts responsables, ne font pas grand-chose pour modifier une culture de la recherche qui frise parfois la mauvaise conduite. »
Le lecteur familier de la pensée complexe aura reconnu la description d’un problème systémique. Qui est une conséquence directe de la perversion propre à la démarche dite «evidence-based » que l’on traduit abusivement de manière courante par « fondée sur les preuves ». Dans un article publié en 2014 dans le Journal of Evaluation in Clinical Practice sous le titre :« Comment la médecine basée sur des preuves échoue en raison d’essais biaisés et d’une publication sélective », Susanna Every-Palmer et Jeremy Howick expliquaient ceci :
« La médecine fondée sur les preuves (EBM) a été annoncée au début des années 1990 comme un « nouveau paradigme » pour améliorer les soins aux patients. Pourtant, il n’y a actuellement que peu de preuves que la « médecine fondée sur les preuves » ait atteint son objectif. Depuis son introduction, les coûts des soins de santé ont augmenté alors que l’on manque toujours de preuves de qualité suggérant que la médecine EBM a entraîné des gains substantiels en matière de santé au niveau de la population (…) nous formulons l’hypothèse selon laquelle le potentiel de la médecine fondée sur les écosystèmes pour améliorer les soins de santé des patients a été contrecarré par des biais dans le choix des hypothèses testées, la manipulation de la conception des études et une publication sélective. Les preuves de ces failles sont les plus claires dans les études financées par l’industrie. Nous pensons que l’acceptation aveugle par l’EBM des « preuves » produites par l’industrie revient à laisser les politiciens compter leurs propres votes. Étant donné que la plupart des études d’intervention sont financées par l’industrie, il s’agit d’un problème sérieux pour la base de données globale. Les décisions cliniques fondées sur ces preuves risquent d’être mal informées, les patients recevant des traitements moins efficaces, moins nocifs ou plus coûteux. »
(…)
Les méthodologies de l’Evidence-Based Medicine ont fait saliver une génération de médecins qui espéraient s’élever vers le Ciel grâce à cette nouvelle religion. Mais le propre de la démarche hypothético-déductive, c’est le réductionnisme. L’on en vient à imaginer pouvoir rétrécir une personne humaine dans toute sa complexité à une simple liste de variables biologiques – ce qui aujourd’hui est tout ce que certains médecins savent encore faire.
Qu’une variable biologique puisse donner une information utile sur une situation clinique, bien sûr, mais la médecine, fondamentalement, est avant tout une praxis, soit à la fois un art et une science. Si l’EBM vient en soutien de cette réalité, c’est bien. Mais quand elle se fait plus grosse que le bœuf, c’est le patient qui explose.
Du fait de ces boursouflures, confusions et compromissions, la médecine est aujourd’hui à risque de perdre son sens et son âme. La « mauvaise » médecine (mauvais diagnostics, mauvais traitements, médicaments toxiques) est devenue aujourd’hui aux États-Unis la troisième cause de mortalité après les maladies cardiovasculaires et les cancers.
(…)
J’ai partagé dans mes précédents billets mon intérêt pour les initiatives de Raoult. Pour les raisons suivantes :
D’abord, il s’agit d’une démarche pleinement empirique, et donc médicale au sens réel et noble. Les idéologues de la « Médecine scientifique » détestent cette idée, Raoult, lui, rappelle que c’est bien cela le paradigme authentique de la clinique. L’on entend toutes sortes de choses au sujet des « faiblesses méthodologiques » de son essai clinique à Marseille. Venant de la part de sectateurs qui cautionnent massivement la destructivité de la biomédecine mercantile, et ferment les yeux sur les faiblesses épistémologiques sévères des protocoles de recherche dont ils se gargarisent, ce n’est précisément pas recevable. Je me permets vraiment d’insister : ce que les pourfendeurs de Raoult ignorent ou feignent d’ignorer, c’est qu’il assume une démarche empirique qui est celle de la vraie médecine, depuis toujours ! C’est comme cela que l’on a utilisé la chloroquine avec succès contre le paludisme et que tous les médicaments anciens ont été mis sur le marché. Je n’ai évidemment rien contre les études bien faites, et comprends d’une certaine manière la validité des critiques formelles adressées à son essai clinique. Il ne se situe toutefois pas dans la même perspective épistémique. Cette contestation conduisant à faire courir un risque majeur à des centaines, voire des milliers de personnes. Un peu comme dans l’histoire de ce type qui laissa brûler sa maison quand on lui eut expliqué que la couleur réglementaire des extincteurs était le rouge, alors que le sien était hélas ! de couleur verte…
Ensuite, il convient de rappeler qu’en période d’urgence, l’on trouve toujours d’un côté ceux qui savent de quoi ils parlent et qui agissent et de l’autre les hordes d’ignorants qui disent n’importe quoi en trouvant que l’urgence est de ne surtout pas agir si l’idée ne vient pas d’eux ou tant qu’il ne leur arrive rien ! L’expérience clinique de Marseille-Infection devrait inciter, je le dis comme je le pense, les tristes sires à se taire, sauf à avoir une expérience clinique comparable avec l’hydroxychloroquine et ses indications anti-infectieuses (sur les bactéries intracellulaires, les parasites et les virus) que Raoult et ses équipes. Ceci devrait prendre soin de cela…
La posture indéfendable des responsables politiques français et des gardiens du temple « scientifique » est de prendre le risque de laisser mourir des centaines de personnes pour ne surtout pas prescrire une substance dont l’on n’est pas « absolument certain » de son effet, alors même qu’elle est parfaitement maîtrisée. Ce qui pose un grave problème éthique. L’éthique, contrairement à la morale, est un arbitrage entre des valeurs contradictoires qui s’opposent les unes aux autres. La démonstration empirique de la capacité d’une molécule (par exemple comme ici) à curer la charge virale et produire une amélioration clinique est bien sûr un principe important. Mais comme l’est tout autant le principe de non-malfaisance bien compris : l’hydroxychloroquine est une substance très sûre, prise par des centaines de millions de personnes depuis des décennies. Alors que le risque de péjoration du tableau clinique de personnes non-traitées, en particulier celles appartenant à un groupe à risque, est susceptible d’avoir des conséquences potentiellement fatales. Enfin, la non-assistance à personne en danger (et même la mise en danger par omission de la vie d’autrui), venant de la part d’autorités politiques et sanitaires, reflète de manière vertigineuse la déliquescence des valeurs et le moralisme autojustifié qui prévalent.
Agnès Buzyn a classé en urgence l’hydroxychloroquine au tableau des « substances vénéneuses ». D’une part, je n’aime pas tirer sur les ambulances, cette dame se trouvant aujourd’hui avec une plainte pénale aux fesses. Mais je vais plus loin : je comprends son souci face au risque d’automédication sauvage à large échelle. Toutefois, je pense que c’est en prenant des mesures méprisantes de l’intelligence des médecins-généralistes et dogmatiques comme on le fait aujourd’hui que l’on tend le ressort pour de tels risques. Rappelons que, non, contrairement au choeur de Cassandres que l’on entend, le profil de risque de l’hydroxychloroquine prescrite sous surveillance médicale (et un électrocardiogramme à J0 et J2) en fait un des médicaments les plus sûrs qui soient. Les avis contraires exprimés en boucle sur les médias confinent au pur mensonge.
Depuis que j’explore les territoires abondants de ma discipline, j’ai toujours observé la même réalité : les vrais scientifiques, quel que soit leur champ disciplinaire, sont toujours des personnes vaillantes, ouvertes d’esprit, curieuses, humbles, déterminées et sachant au besoin s’affranchir des règles inutiles. Dans le sillage de ces grandes personnalités, l’on trouve ensuite des hordes de suiveurs sans talent et qui se tiennent pour sortis de la cuisse de Jupiter. Ils forment le bataillon noir des « intégristes », confondant science et religion et injectant dans leur pratique de la première le même cléricalisme imbécile qui afflige la Curie romaine. Puis, en-dessous, la masse invisibles des chercheuses et chercheurs de bonne volonté, invisibles, sous-payés, abondamment maltraités par les dynamiques malsaines de leurs institutions*.
Note de B&SD :
* L’article intégral de Jean-Dominique Michel, “Hydroxychloroquine : comment la mauvaise science est devenue une religion” peut être trouvé ici.
Source : https://claude-rochet.fr/laffaire-chloroquine/

Claude Rochet, né le 11 mars 1949 à Paris, est un économiste du développement et haut fonctionnaire français.
Il est titulaire d’une maîtrise et d’un CAPES d’histoire, licencié en langue et civilisation chinoises, ancien élève de l’ENA (promotion Fernand Braudel de 1987), diplômé de l’Institut des Hautes Etudes de la Sécurité Intérieure, option Intelligence économique et docteur en sciences de gestion (2005), habilité à diriger des recherches, qualifié professeur des universités en 2007.
Il a été professeur des universités associé à l’Institut de management public et de gouvernance territoriale d’Aix-en-Provence (Université d’Aix-Marseille), conseiller scientifique du Coordinateur ministériel à l’intelligence économique, directeur du laboratoire de recherche et de la formation du Service de coordination à l’intelligence économique du Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie jusqu’à son départ en retraite le 1er juillet 2016. Il a été directeur de recherche au CERGAM de l’Université d’Aix-Marseille puis au LAREQUOI de l’Université de Versailles Saint Quentin-en-Yvelines et est actuellement co-directeur de recherche à l’Université Paris Dauphine (Wikipedia.)
[…] L’affaire Chloroquine – par Claude Rochet. […]