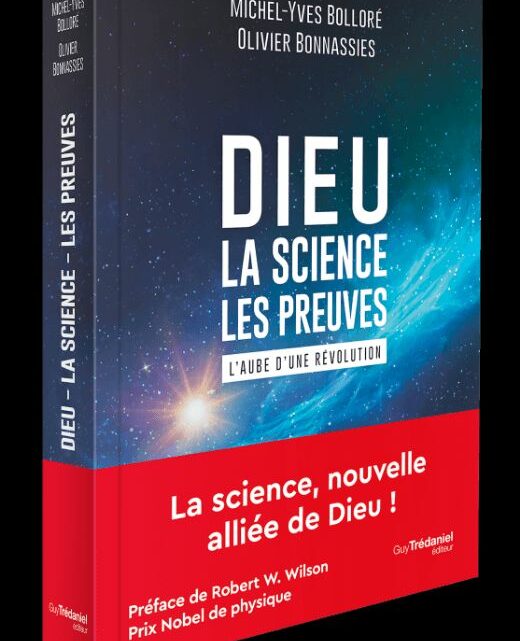
L’aube d’une révolution ?
Par Dominique Tassot
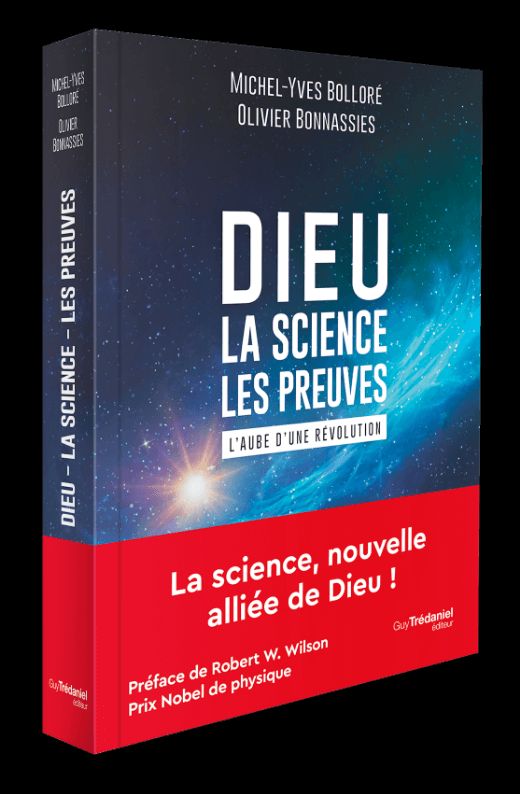
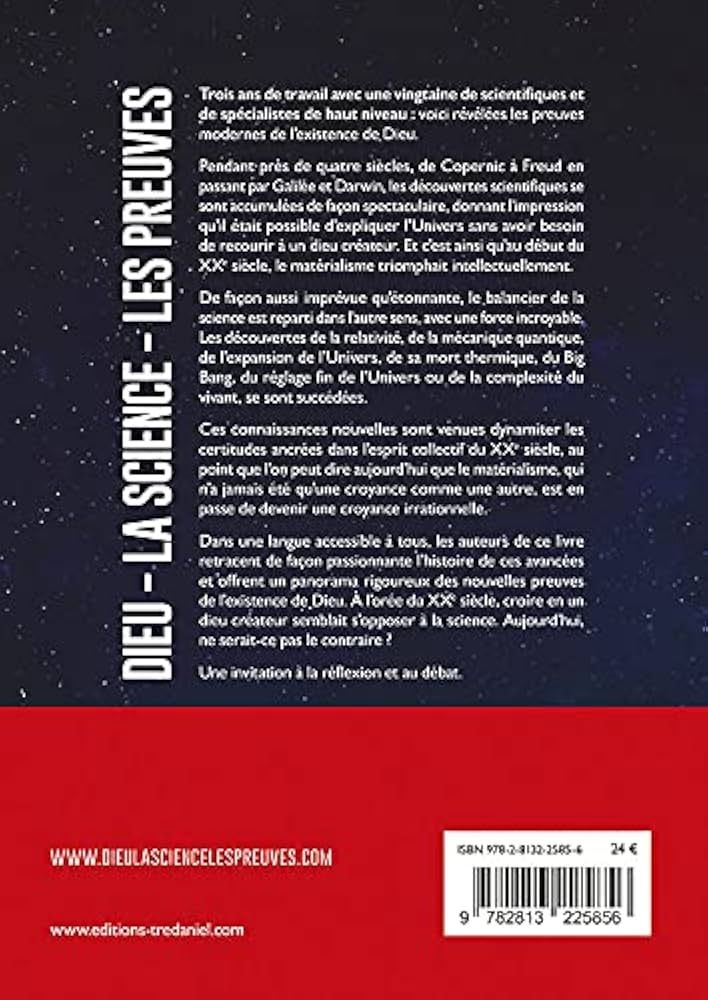
Présentation : Le livre Dieu, la science, les preuves est un événement de librairie. Avec un savoir consommé de communicants, les deux auteurs, entourés d’une pléiade de conseillers qualifiés, viennent annoncer à nos contemporains, étourdis par la propagande matérialiste et les préjugés anticléricaux de nombreux enseignants, qu’un Dieu créateur immatériel est bien à l’origine de tout l’Univers visible et que la science du XXe siècle l’établirait avec certitude. Il est réjouissant de voir ainsi renaître une démarche apologétique que les théologiens, encore sous le coup du « syndrome de Galilée » avaient délaissée pour se réfugier dans le « discordisme » en faisant de la science et de la foi deux domaines séparés par une cloison étanche.
Cela dit, il peut être dangereux de vouloir « prouver » le Dieu créateur, l’Absolu, par des arguments humains, donc relatifs et faillibles. De là différentes réserves qu’il nous importe de faire, tant sur certains arguments avancés – en particulier la théorie du Big Bang et le présupposé évolutionniste – que sur l’inévitable dévalorisation de l’Écriture Sainte qui en résulte.
Un livre à succès vient de paraître dont le titre, soigneusement pesé, s’énonce : Dieu, la science, les preuves, avec comme sous-titre : L’aube d’une révolution1. Ce gros ouvrage renoue avec une discipline plutôt délaissée depuis un siècle : l’apologétique, à savoir la justification par la raison des principaux énoncés de notre foi, « croire [étant] un acte de l’intelligence adhérant à la vérité divine sous le commandement de la volonté mue par Dieu au moyen de la grâce2 ». Dans le cas présent, il ne s’agit pas d’entrer dans les articles détaillés de la foi chrétienne, mais, plus généralement, de confronter la thèse de l’existence d’un Dieu créateur avec les résultats de la science actuelle.
« S’il a été difficile aux croyants d’accepter Galilée et Darwin, alors que, sur le fond, leurs découvertes n’étaient pas incompatibles avec leur foi, il sera bien plus difficile encore aux matérialistes d’accepter et d’assimiler la mort thermique de l’Univers et ses réglages fins, car ces découvertes leur posent des problèmes insurmontables.
Il ne s’agit pas là, en effet, d’une simple mise à jour de leur pensée, mais d’une remise en cause radicale de leur univers intérieur » (pp. 24-25).
« Le phénomène est particulièrement aigu quand on aborde le sujet de l’existence d’un dieu créateur. Face à cette question, les passions sont bien plus fortes encore, car ce qui est en jeu, ce n’est pas une simple connaissance, mais bien notre vie même. Avoir éventuellement à reconnaître, en conclusion d’une étude, que l’on pourrait n’être qu’une créature issue et dépendante d’un créateur est perçu par un grand nombre comme une remise en cause fondamentale de leur autonomie » (p. 25).
À vrai dire, cette question n’est pas nouvelle. Voltaire écrivait déjà :
« Dans le système qui admet un Dieu, on a des difficultés à surmonter ; et dans tous les autres systèmes, on a des absurdités à dévorer3. »
Et Voltaire était si conscient de l’autorité intellectuelle acquise par les savants qu’il avait demandé à sa compagne, la marquise du Châtelet, la tâche de traduire en français, alors langue de l’Europe cultivée, les Principia de Newton !
Alors, qu’apportent de vraiment nouveau les 580 pages écrites par Michel-Yves Bolloré4 et Olivier Bonnassies5, et qui ajouterait aux mots sarcastiques de Voltaire ou à la petite dizaine de lignes dont un traité de métaphysique médiévale aurait fait usage pour exposer la preuve de l’existence de Dieu par l’ordre du monde6 ?
Nous répondrons tout d’abord que, nos contemporains ayant désappris l’art de penser par eux-mêmes, il était devenu nécessaire de les impressionner avant que de les convaincre. Le livre s’y emploie à merveille en produisant par exemple cent citations de grands savants, souvent prix Nobel : c’est même l’objet spécifique du chapitre 12.
Ainsi Alfred Kastler, prix Nobel de physique 1966 :
« L’idée que le monde, l’Univers matériel, s’est créé tout seul me paraît absurde ; je ne conçois pas le monde sans un créateur, donc un Dieu. Pour un physicien, un seul atome est si compliqué, si riche d’intelligence, que l’Univers matérialiste n’a pas de sens » (p. 250).
George Thomson, colauréat du Nobel de physique 1937 :
« Il est probable que tous les physiciens croiraient à une création si la Bible n’en avait malheureusement touché un mot il y a bien longtemps, lui donnant un petit air vieillot » (p. 252).
Carlo Rubbia, prix Nobel de physique 1984 :
« Parler de l’origine du monde nous amène inévitablement à penser à la création et, en regardant la nature, nous découvrons qu’il y a un ordre trop précis qui ne peut pas être le résultat d’un “hasard”, d’affrontements entre “forces” comme nous, les physiciens, continuons à le soutenir. Cependant, je crois que l’existence d’un ordre préétabli dans les choses est plus évidente chez nous que chez les autres. Nous venons à Dieu par le chemin de la raison, d’autres suivent le chemin de l’irrationnel » (p. 258).
Wernher von Braun, inventeur du V2 allemand :
« Être forcé de ne croire qu’en une seule conclusion – que tout dans l’Univers soit apparu par le fait du hasard – violerait l’objectivité de la science elle-même. […] Quel processus aléatoire pourrait produire le cerveau d’un homme ou le système de l’œil humain ? » (p. 264).
Roger Sperry, prix Nobel de médecine 1980 :
« Il me paraît indispensable de contester avec la dernière rigueur la conception matérialiste et réductionniste de la nature et de l’esprit humain, conception issue – semble-t-il – de l’attitude objective et analytique aujourd’hui prédominante dans les sciences du cerveau et du comportement. […] Je soupçonne que nous avons été dupés, et qu’à la société et à elle-même la science n’a fourgué que de la camelote » (p. 274).
Ce chapitre est d’ailleurs suivi par une intéressante analyse de sondages récents sur les croyances des scientifiques (p. 282). Même si ces sondages divergent entre eux, la tendance générale est que la proportion de croyants décroît avec le niveau de vie et le niveau d’études – cela, on le savait déjà ! –, mais que les scientifiques croyants représentent la moitié de l’échantillon (et même les deux tiers chez les chercheurs de moins de 34 ans) et que 10 % seulement des prix Nobel en sciences se déclarent athées (contre 35 % chez les Nobel de littérature). L’explication donnée par les auteurs est simple et rejoint la thèse générale du livre :
« Le caractère très récent des preuves scientifiques en faveur de l’existence d’un dieu créateur. Elles ont toutes, en effet, moins d’une génération :
- La mort thermique de l’Univers n’est certaine que depuis 19987..
- La nécessité d’un début de l’univers, quel qu’il soit (théorème de Borde-Guth-Vilenkin), date seulement de 2003.
- La découverte de la complexité de l’ADN et de la moindre cellule vivante, qui induit l’improbabilité du passage, par le seul hasard, de l’inerte au vivant, a également moins d’une génération.
Ces découvertes génèrent de nos jours des polémiques qui ressemblent à celles provoquées en leur temps par les découvertes de Galilée ou de Darwin. Ces controverses sont probablement aussi inévitables que celles qui ont eu lieu à leur époque. Combien de temps a-t-il fallu pour que les découvertes de Darwin soient acceptées ? Cent ans, cent cinquante ans peut-être ? N’en doutons pas, les preuves nouvelles de l’existence de Dieu mettront sans doute aussi un peu de temps à produire leur effet » (pp. 289-290).
Nous touchons ici un des points faibles de cet ouvrage, si sympathique qu’en soit le projet : l’idée qu’à l’issue des inévitables controverses, surgit un consensus entre spécialistes donnant des certitudes8. Or ce consensus, résultant souvent de la cooptation des académiciens et des titulaires de chaires universitaires, est illusoire. Ou, plutôt, les degrés de certitude, en sciences, demeurent relatifs.
Un exemple parmi d’autres : la non-hérédité des caractères acquis. Ce fut, dans les années 1890, un argument majeur contre l’évolutionnisme – qu’il se prétendît lamarckien ou darwinien, d’ailleurs – suite aux expériences menées par August Weismann9. Il fallut attendre la théorie des mutations, à partir de 1901, pour redonner un fondement rationnel crédible à l’existence de variations individuelles transmissibles à la descendance. Avec la découverte de l’ADN mitochondrial et de l’épigénétique, la question a pris aujourd’hui une tournure nouvelle : les mêmes mots (hérédité, caractères) finissent par ne plus désigner les mêmes choses. Ce n’est qu’en mathématiques, où l’objet de science s’épuise dans la définition que l’on en donne, qu’un haut degré de certitude peut être atteint.
Un autre exemple sera celui du Big Bang. À lire les auteurs, la théorie du Big Bang avec sa chronologie milliardaire, son inflation de l’espace-temps et toutes les rustines qu’il a fallu y rajouter en cours de route pour contourner les observations contraires10 serait l’argument majeur qui « prouve » l’existence de Dieu : 100 pages lui sont consacrées11, avec un historique détaillé et, en sus, un intéressant argument historique : les bolchéviques et les nazis ont persécuté les physiciens favorables au Big Bang.
Hélas ! Les ennemis de nos ennemis ne sont pas forcément nos amis ! Que des évolutionnistes athées comme Staline et Hitler aient vu un danger dans une théorie inventée par un prêtre et niant l’éternité de la matière était assez naturel. Qu’ils aient cru pouvoir lutter avec des mesures policières contre une production de l’esprit humain est à la fois tragique et dérisoire. Il n’en reste pas moins que la cosmologie officielle souffre de maux rédhibitoires : les observations dérangeantes d’Alton Arp ou de Valery Kotov sont purement et simplement écartées12. Lorsque le rayonnement de fond cosmique à 2,73° Kelvin fut découvert, en 1965, quatre modèles différents l’avaient prédit : certes, en 1948, Alpher et Herman le donnaient à 5° K, mais en 1926 Eddington l’avait calculé à 3,2° K ; toujours en 1926 Regener annonçait 2,8° K et, en 1964, Fred Hoyle avait proposé 2,78° K.
La règle usuelle, en science, demandait donc que l’observation fût présentée comme confirmant le modèle permanent de Hoyle, dont le résultat était le plus proche de la valeur observée, et comme réfutant le Big Bang dont le résultat était le plus éloigné. Pourtant, dès le lendemain de la découverte, la presse internationale déclarait haut et fort que le Big Bang était enfin prouvé13 ! La solution fut, bien sûr, de rafistoler les équations pour se rapprocher de la valeur mesurée.
Contrairement à ce qu’affirment nos deux auteurs, les critiques scientifiques du Big Bang n’ont jamais cessé. On retrouvera ci-après une Lettre ouverte à la communauté scientifique, inspirée par Jean-Claude Pecker, professeur au Collège de France et membre de l’Académie des sciences, Lettre publiée par le New Scientist le 22 mai 2004. Il y avait alors 33 autres cosignataires représentant 10 nations et des institutions prestigieuses. En 2005, lorsque nous avions publié une première fois cette Lettre – dans Le Cep n°31 –, les cosignataires étaient déjà plus de 200. Ils sont 500 aujourd’hui, ce qui est considérable pour un domaine scientifique aussi pointu.
Il faut souligner la conclusion de la Lettre : si les seules recherches recevant des financements sont celles qui travaillent dans le cadre du Big Bang, il est inévitable que les publications officielles donnent l’impression de confirmer ce modèle.
Les dissidents parvinrent à se réunir pour une première conférence à Monção (Portugal) en juin 2005. Eric Lerner y déclarait : « Les prédictions du Big Bang sont constamment fausses et elles sont arrangées après l’événement14.»
Nous considérons donc qu’il est stratégiquement imprudent de lier la crédibilité d’un Dieu créateur à la pérennité d’une théorie en réalité controversée, même si des autorités académiques, des revues de vulgarisation et même des manuels de science présentent ce modèle comme un « fait » historique bien daté. En outre, contrairement à ce qu’affirment les deux auteurs, de puissants arguments apologétiques tirés de la science se sont présentés à toutes les époques, y compris au siècle scientiste par excellence que fut le XIXe siècle. Lord Kelvin avait d’ailleurs réfuté Darwin en calculant que le temps de refroidissement de la Terre ne permettait pas les millions d’années nécessaires à une évolution graduelle des espèces. On objectera que la découverte de la radioactivité a récusé le calcul théorique de Lord Kelvin, puisqu’elle permet un apport d’énergie interne s’ajoutant à celle reçue du soleil. Mais cette réfutabilité montre simplement le danger de s’appuyer sur un modèle scientifique comme s’il était pérenne par nature.
Comme le notait Maurice Allais, pour qu’une théorie scientifique soit vraie, il ne suffit pas qu’elle puisse interpréter les faits, il faudrait encore pouvoir montrer qu’elle sera la seule à le faire, et cela est manifestement impossible. Que des scientifiques soient volontiers croyants n’est pas une spécificité de notre siècle : de tout temps, l’étude fine des êtres et des choses a montré l’existence d’un ordre sensé et l’absence de hasard, compris ici comme ce qui traduit l’irrationnel.
Vers 1915, le jésuite Antonin Eymieu (1861-1933) s’est livré à une étude statistique détaillée sur les croyances de ceux qui avaient marqué la science au cours du siècle précédent. Son enquête, classée par grandes disciplines, portait sur 432 noms qui ont illustré les sciences exactes et les sciences de la nature.
Outre 34 savants dont l’attitude religieuse est inconnue, il en reste 398 répartis ainsi : 15 indifférents ou agnostiques, 16 athées et 367 croyants (92 %). Et si l’on restreint l’étude aux initiateurs, à ceux qui ont produit les innovations essentielles, la proportion augmente encore. Eymieu en retint un total de 150 se partageant ainsi : 13 dont les sentiments religieux sont inconnus, 9 indifférents ou agnostiques ; et sur les 128 qui ont pris position, 5 seulement (soit 4%) sont athées et 123 croyants (soit 96%)15. Quand Eymieu évoque ici la « croyance religieuse », il s’agit sans aucune exception du christianisme, c’est-à-dire de la religion de la Révélation biblique complète, achevée, et qui reçoit l’Ancien et le Nouveau Testaments comme Parole de Dieu.
Il est donc difficile de nier que les grands scientifiques du XIXe siècle ont été – et de beaucoup ! – plus croyants que la moyenne de leurs contemporains, qu’ils ont mieux résisté à la pression sociale, et donc que la vision biblique du monde, qui orientait leurs convictions et leurs personnes eut un effet positif sur les progrès de la science.
Le chapitre 11 de Dieu, la science, les preuves, sur la biologie : « Le saut vertigineux de l’inerte au vivant », nous paraît excellent, même s’il entérine la thèse évolutionniste voulant qu’une première cellule, LUCA (Last Universal Common Ancestor), soit apparue « il y a environ 3,5 à 3,8 miliards d’années, soit environ 1 milliard d’années après l’apparition de la Terre » (p. 218). Les auteurs concèdent cependant que les expériences d’Oparine et de Miller pour synthétiser « quelques petites briques du vivant » à partir d’une soupe primordiale ne constituent « qu’un pas infime. En effet, le fossé séparant l’inerte du vivant s’ouvre toujours, béant, sous les yeux des scientifiques qui n’ont jamais, pour l’instant, posé qu’un tout petit jalon pour tenter la traversée » (p. 221).
Or la différence entre l’inerte et le vivant ne relève pas d’un simple « fossé » plus ou moins large : elle est abyssale, ontologique. En effet, Dieu a créé l’univers ex nihilo (2 Maccabées 7:28) par Sa Parole, et Il a créé (verbe hébreu ברא bar’a, en Genèse 1:21 & 27) et a formé (verbe hébreu עשה a‘shah, en Genèse 1:25 & 31)16 des êtres vivants complets, conformes – dès le début – à la nature voulue pour eux par le Créateur. Il est donc inexact d’évoquer : « entre l’inerte et le vivant, le même rapport qu’entre une pièce détachée et une voiture » (p. 221).
Ici encore, la science du XXe siècle n’a fait que confirmer (par la découverte de la complexité indéfinie de l’être vivant) ce qui était déjà bien connu. Le chanoine Henry de Dorlodot, lui-même darwinien convaincu et qui représenta l’université de Louvain à Oxford, en 1909, pour le centenaire de la naissance de Darwin, reconnaissait déjà que « l’évolutionnisme intégral » – donc y compris l’apparition de la vie par des processus naturels – n’était pas établi. Et Leibniz avait remarqué une différence de nature entre les rouages d’une machine et les organes d’un être vivant. Chez ce dernier, notait-il, les « rouages » sont eux-mêmes des machines comportant des sous-organes et ainsi de suite.
Ce très intéressant chapitre 11 montre bien que des protéines ou des enzymes ne pourront jamais s’assembler par pur hasard pour former une cellule vivante, mais il n’était nullement nécessaire, pour parvenir à ce résultat, de laisser entendre que l’actuelle vision évolutionniste de l’origine des espèces – fût-elle partagée par de grands noms de la science – était solidement fondée.
On touche ici un autre point faible du livre. Sa force tactique consiste en un argument d’autorité : les grands savants de notre époque admettent un réglage si fin des paramètres de l’Univers et une improbabilité si forte de l’apparition simplement naturelle de la vie qu’il faut conclure à l’existence d’un Créateur. Donc la science d’aujourd’hui « prouve » Dieu. C’est ici fonder l’Absolu sur le relatif.
La science contemporaine, il est vrai, développe des arguments nouveaux dont l’apologète a le devoir de se servir. Mais une telle situation a valu, vaut et vaudra pour toutes les époques. En 1953, avant donc la vulgarisation du modèle big-banguiste, Pie XII l’avait magnifiquement formulé, en l’élargissant encore, dans une déclaration aux étudiants catholiques de la Sorbonne le 15 avril 1953 : « Soyez convaincus qu’entre des vérités de foi certaines et des faits scientifiques établis, la contradiction est impossible17». Mais il parlait de « faits » et non de « théories ».
Des théories comme le modèle mathématique du Big Bang ou le néodarwinisme demeurent des thèses dont on discute encore et ne sont nullement des « faits établis » sur lesquels il serait raisonnable de s’appuyer.
Un troisième point faible est le concordisme involontaire de nos deux auteurs. Bien entendu, ils se défendent de « faire du concordisme » dont le seul soupçon écarterait d’eux tous les théologiens qu’ils veulent au contraire intéresser et conforter. Reste qu’historiquement le concordisme, système d’exégèse né au XIXe siècle et parfois nommé « périodisme », a consisté à identifer les « Jours » de la Création avec les ères géologiques, ce qui semblait prouver l’inspiration divine de Moïse. Comment un Égyptien, même instruit, mais né quinze siècles avant Jésus-Christ, pouvait-il savoir ce que les géologues viennent seulement de découvrir ? Or la Genèse fait apparaître en parallèle, au cinquième Jour, les oiseaux et les poissons, alors que la paléontologie évolutionniste fait descendre des seconds les ancêtres des premiers. Le premier concordisme fut donc une erreur tragique : faire confiance aux théories scientifiques comme s’il s’agissait encore de savoirs empiriques bien constatés.
Mais il existe aujourd’hui un autre concordisme (dont le père Teilhard a donné un exemple caricatural), qui consiste à repenser l’interprétation des dogmes pour les adapter à la théorie scientifique du moment.
Pour nos auteurs, « dans notre civilisation technicienne, fonctionnant presque uniquement sur des écrits précis, nous sommes habitués à ce que la valeur de la conclusion d’un texte (c’est-à-dire son message) repose entièrement sur la véracité du texte (le récit) qui l’accompagne » (p. 369). Mais il en va différemment des textes littéraires et la Bible devra donc être lue en tenant compte de son genre littéraire particulier : « Dans le texte biblique, le récit qui porte le message est certes imagé, en vue de sa mémorisation, de sa transmission et de sa compréhension par tous, mais il est en général inspiré de faits réels, même s’ils ont été simplifiés, amplifiés ou hyperbolisés » (pp. 370-371)18. Quelques exemples sont donnés : le Déluge universel fut « sans doute plus local et plus limité que celui qui est décrit » (p. 371) ; ainsi « l’invraisemblance » de l’Arche de Noé ; ainsi la traversée de la mer Rouge, dont la réalité historique est difficile à cerner, est-elle un « épisode » dans le récit de l’Exode, une histoire « complètement distincte » d’une « deuxième histoire, à caractère surnaturel : l’exode des élus que Dieu arrache à l’esclavage du mal par leur libérateur, le Christ, vers le paradis éternel » (p. 375). Évidemment, c’est le message dont la vérité importe, pas le franchissement miraculeux de la mer Rouge.
En dévalorisant ainsi le sens littéral de l’Écriture, on évite bien sûr les conflits frontaux avec la science rationaliste : « Ainsi, ces grands récits de la Bible ne sont pas des erreurs, ils nous racontent des événements historiques imagés dont nous ne connaissons pas la réalité exacte, ce qui une fois de plus est sans importance » (p. 379).
Rappelons ici que la vieille idée de restreindre l’inerrance biblique aux questions de foi et de mœurs (et donc d’admettre l’existence de données historiques ou scientifiques inexactes) avait été condamnée successivement par Léon XIII, Pie X et Benoît XV, ce qui amena Pie XII, dans Humani Generis (1950) à la qualifier « d’opinion bien des fois condamnée19».
Le résultat final de ce concordisme pratique est de diluer la vérité de la Bible pour la rendre compatible avec la vision scientiste du monde à laquelle – quoiqu’ils s’en défendent – nos deux auteurs se raccrochent. On comprend mal, dès lors, l’excellent chapitre consacré aux apparitions de Fatima avec le « miracle du soleil ». Il y eut 70 000 spectateurs et autant de témoins. Mais le peuple hébreu qui a traversé la mer Rouge, estimé à 600 000 hommes (Exode 12:37), fut lui-même témoin du miracle. Pourquoi dévaloriser le témoignage antique – certes sans photographie, mais l’incomparable Cantique de Moïse (en Exode 15:1-21) ne vaut-il pas pièce à conviction ? – et se saisir d’un témoignage récent dont les derniers spectateurs sont désormais trépassés ?
Le livre entend prouver l’existence d’un Dieu créateur et se défend de promouvoir une religion particulière. Mais un chapitre discute des titres qu’il convient de donner à Jésus-Christ (sage, illuminé, aventurier, prophète, messie, Fils de Dieu ?) et un autre établit le caractère miraculeux de la guerre des Six Jours, dont certains ont expliqué la brièveté en notant que Dieu ne travaille pas le septième Jour (p. 444). En réalité, le « doigt de Dieu » se laisse voir à chaque grand tournant de l’Histoire, même si les manuels scolaires ne nous permettent guère de deviner à quel point les événements survenus étaient, à vues humaines, quasi improbables, « une somme d’accidents inexplicables » comme dit un écrivain…
On pourrait commenter longuement cet ouvrage composite, fruit d’un vaste travail collectif méritoire et procédant d’une excellente intention. Certains philosophes ont déjà noté le danger d’attribuer à la science une qualité de certitude qu’elle ne possède pas.
Notre principal reproche sera d’avoir voulu fonder la démonstration sur un consensus scientifique qui n’a jamais existé et, pour ce faire, de donner dans la grande erreur qui consiste à croire que la science humaine peut expliquer l’origine de quoi que ce soit. La grenouille a voulu se faire aussi grosse que le bœuf, mais l’issue de l’histoire est certaine : la science-baudruche va heureusement se dégonfler et se remettre à sa vraie mission : connaître. Rendre compte de ce qui est, du fonctionnement de l’Univers, des liens entre les êtres, des merveilles de la vie, et laisser le Créateur témoigner Lui-même de ce que Sa Parole a produit au Commencement, un commencement dont la science n’a rien à dire puisqu’elle ne porte que sur le cosmos complet, achevé, celui du Septième Jour, à partir duquel seulement la science est devenue possible.
Alors, il ne sera plus nécessaire de dévaloriser l’Écriture pour la déclarer indemne « d’erreurs ». Alors reprendra corps l’authentique vision biblique du monde, celle qui avait inspiré les fondateurs de la science européenne, la vision d’une nature régie par de sages lois issues d’une Intelligence ordonnatrice incomparable, mais cependant si intimement proche des hommes qu’Elle nous a faits à Son image et animés de Son Esprit. Alors luira à coup sûr l’aube d’une authentique révolution intellectuelle : remettre la science, activité humaine menant en effet à Dieu, à sa juste place.
Article reproduit ici avec l’aimable autorisation de Dominique Tassot que nous remercions chaleureusement.
Notes
- Michel-Yves BOLLORÉ & Olivier BONNASSIES, Dieu, la science, les preuves, L’aube d’une révolution. La science, nouvelle alliée de Dieu !, Paris, Éd. Guy Trédaniel, 2021. ↩︎
- S. THOMAS d’Aquin, Somme de théologie, IIa-IIæ, q. 2, art. 9 ; cf. Cc. Vatican I, DS 3 010. ↩︎
- VOLTAIRE, Œuvres complètes, annot. Louis Moland, Paris, Garnier, 1877-1879, t. XXII, p. 200. ↩︎
- Ingénieur ENSI-Toulouse, docteur en gestion (Dauphine), longtemps à la direction industrielle du groupe Bolloré, puis président-fondateur du groupe France-Essor. ↩︎
- X 86, ayant suivi la formation de l’Institut HEC Start-up et titulaire d’une licence de théologie, il a lancé différentes entreprises et le site catholique d’information Aleteia, diffusé quotidiennement en 7 langues. ↩︎
- Le livre comporte cependant, à la fin, un bref chapitre exposant des preuves philosophiques classiques de l’existence de Dieu. ↩︎
- En réalité, l’accélération de la récession galactique (qui consomme de l’énergie, donc refroidit) fut une surprise totale pour les tenants du Big Bang. En revanche, elle était prévue par la cosmologie de Hoyle : une récession exponentielle de constante de temps R/c, où R est le rayon de Hubble (F. SANCHEZ). ↩︎
- Il importe de bien distinguer entre la théorie de la science – cette dernière étant supposée valider ses modèles par des prédictions vérifiées expérimentalement : science réputée « hypothético-déductive » – et la réalité de la science, activité humaine soumise à des considérations d’intérêt, de vanité ou d’incompréhension des éléments nouveaux. ↩︎
- Il coupa la queue de souriceaux sur un grand nombre de générations successives, sans jamais obtenir l’atrophie ou la disparition d’un organe pourtant devenu apparemment inutile. ↩︎
- Nous renvoyons ici aux articles de Thomas SEILER dans Le Cep n° 95 et n° 96. ↩︎
- Pour un des auteurs, « le Big Bang a pu éventuellement être précédé d’autres singularités (il n’est pas nécessairement le début absolu de tout, même s’il y ressemble beaucoup), mais on peut toutefois affirmer, à partir de raisonnements rationnels (p. 61, 91 et 515-517), de la thermodynamique (p. 55 à 72) et de la cosmologie (p. 100, 165, 206, 210 et 214, et avec le très robuste théorème de Borde-Guth-Vilenkin), que le temps, l’espace et la matière, qui sont liés (comme Einstein l’a montré), ont eu très certainement un début absolu, et donc qu’à l’origine de cette émergence, il y a une cause qui est, par définition, transcendante à notre Univers, non matérielle, non spatiale, non temporelle (pp. 91-92), dotée de la puissance de tout créer et de tout régler de façon infiniment précise, afin que les atomes, les étoiles et l’homme puissent advenir (p. 171 à 248) » ; courriel personnel reçu d’Olivier Bonnassies auquel cet éditorial a été soumis avant publication.
Bien entendu, nous ne contestons pas l’affirmation par la raison de l’existence d’un Dieu transcendant, mais récusons la valeur technique de certains arguments avancés, de même que certains présupposés de la démarche apologétique, en particulier la mise de côté de la pertinence scientifique et historique de la Bible. ↩︎ - Cf. F. SANCHEZ, « La science officielle à l’épreuve du nouveau télescope spatial », Le Cep n° 97, décembre 2021, p. 23. ↩︎
- Cf. Th. SEILER, « La doctrine de la Création et l’astronomie », Le Cep n° 96, p. 8-9. ↩︎
- Cf. Brad HARRUB, « La faillite du Big-bang », Le Cep n° 33, p. 20. ↩︎
- A. EYMIEU, La part des croyants dans les progrès de la science au XIXe siècle, Paris, Perrin, 1920, t. II, pp. 274-279. ↩︎
- La Septante emploie ici un seul verbe grec pour « créer » et « faire » : ποιέω poiéô. La Vulgate latine distingue bien, suivant l’hébreu, creo et facio. ↩︎
- Souligné par nous. ↩︎
- On reconnaît ici les thèses, ou théories, du dominicain Marie-Joseph Lagrange (1855-1938) – fondateur de l’École pratique d’études bibliques en 1890 (devenue École biblique et archéologique française de Jérusalem en 1920), puis de la Revue biblique en 1892 –, en particulier celles des « genres littéraires » et du « fait générateur » réel, mais inconnu car perdu « dans la nuit des temps »… ↩︎
- Sur cette question, on pourra se reporter à D. TASSOT, La Revanche du Lièvre…De la portée scientifique de l’Écriture, Versailles, Via Romana, 2014. ↩︎
A propos de l’auteur

Ingénieur des Mines de Paris, ayant soutenu en Sorbonne une thèse de doctorat de philosophie sur la dialectique de la science et de la Révélation (De Galilée au Père Lagrange), Dominique Tassot s’est passionné pour les rapports complexes qu’entretiennent la science et la foi. Il anime le Centre d’Études et de Prospective sur la science (CEP) dont il dirige la revue Le Cep. Il a été l’un des orateurs du Premier congrès national Bible et Science qui s’est tenu du 25 au 27 octobre 2019 à Mulhouse.