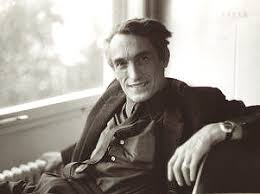
Marcel-Paul Schützenberger : les failles du darwinisme
Interview de Marcel-Paul Schutzenberger, membre de l’Académie des sciences, accordée à la revue La Recherche en 1996, peu de temps avant sa mort.
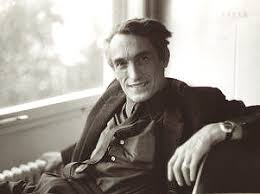
Marcel-Paul Schutzenberger (1920-1996) était mathématicien, expert en informatique théorique, médecin, généticien et épidémiologiste, spécialiste du pian (une maladie infectieuse chronique des pays tropicaux), fut élu à l’Académie des sciences en 1988 et travailla sur la théorie des codes et apporta de grandes contributions à la compréhension mathématique du codage de l’information. Il obtint un doctorat en médecine en 1949, puis en 1953 un doctorat de mathématiques sur les « Contributions aux applications statistiques de la théorie de l’information ». Il fut professeur à l’université de Poitiers, où il enseignait notamment la statistique, de 1957 à 1963 ; enseignant à la Faculté de médecine de Harvard durant l’année 1961-62 ; directeur de recherches à l’Institut Blaise Pascal du CNRS durant l’année 1963-64 , et directeur scientifique à l’IRIA (ancien nom de l’INRIA) de 1968 à 1972.
La Recherche : Quelle est votre définition du darwinisme ?
M.-P. Schützenberger : Je prendrai la version moderne la plus courante, dont un représentant offensif est le Britannique Richard Dawkins. Elle consiste à considérer que l’évolution des êtres vivants peut être expliquée par le tandem sélection-mutations au hasard. A l’intérieur de cette doctrine, il faut distinguer deux écoles, mutuellement contradictoires : les gradualistes, dont Dawkins est le héraut le plus radical, et les saltationnistes, dont l’Américain Stephen Jay Gould est un héraut non moins radical. Pour les gradualistes, l’évolution procède uniquement par petites touches successives. Pour les saltationnistes, qui n’ont d’ailleurs pas fourni l’effort d’une présentation aussi structurée, l’évolution procède essentiellement par sauts.
L.R. : Vous êtes plus connu comme mathématicien que comme spécialiste de l’évolution…
M.-P. S. : Bien sûr, mon métier n’est pas la biologie. Mais la légitimité des mathématiciens dans ce débat vient d’abord de ce que les plus dogmatiques des gradualistes, Dawkins en tête, font un grand usage d’arguments formulés en termes mathématiques et informatiques, qui en imposent au lecteur.
Cette légitimité vient aussi du fait que les mathématiciens sont des zélotes de l’épistémologie, dans leur propre discipline. Il est normal qu’ils portent un regard critique analogue sur les fondements d’autres disciplines.
Elle vient enfin de l’irruption dans ce débat, dans le sillage du mouvement cybernétique, de mathématiciens et de physiciens, comme René Thom ou Ilya Prigogine, et plus récemment des chercheurs de l’institut Santa Fe, aux États-Unis, comme Stuart Kauffman, un médecin épris de logique mathématique qui reçoit l’appui sonore du grand physicien Murray Gell-Mann. Ce troisième conglomérat d’Églises applique des concepts mathématiques au problème fondamental de l’évolution, qui est celui de complexité fonctionnelle. Ici je me trouve concerné de manière plus personnelle.
L.R. : Qu’entendez-vous par complexité fonctionnelle ?
M.-P. S. : Sans ce concept, il est impossible d’envisager les phénomènes de la vie. Les deux mots qui le composent désignent eux-mêmes deux notions essentielles.
Quand un biologiste qui travaille à la paillasse se parle à lui-même, parfois à voix basse, en termes de fonctions la fonction d’un gène, d’une enzyme, du ribosome, des antennes de la drosophile, il pense fonctionnalité et il a bien raison de le faire. C’est un concept parfaitement adapté à la réalité. Ceux qui le perçoivent mieux que quiconque sont les physiologistes. Pour eux tout est fonctionnalité. Ils décrivent des systèmes : circulatoire, digestif, excrétoire, etc. Qu’il en aille de même en biologie moléculaire semble poser des problèmes à certains. Peut-être parce que la notion d’organe n’est plus présente à ce niveau. Mais l’absence d’organe n’interdit pas qu’on parle de fonctions ! La complexité est aussi un concept de base. Déjà chez les unicellulaires les mécanismes de séparation et de fusion des chromosomes, dans la mitose et la méiose, sont des processus incroyables de complexité, de finesse.
Or les êtres vivants se présentent comme un ensemble complexe d’interrelations fonctionnelles. Si l’on veut expliquer l’évolution des êtres vivants, il faut expliquer à la fois cette fonctionnalité et cette complexité. C’est la complexité fonctionnelle. Et là ce n’est plus simple du tout…
L.R. : Qu’y a-t-il de si difficile à comprendre ?
M.-P. S. : C’est peut-être que l’évolution du vivant repose sur un quelque chose, un ingrédient essentiel que rien dans nos connaissances physico-chimiques actuelles ne permet d’imaginer, et sur lequel la logique formelle n’a pour l’instant aucune prise. Qu’ils soient gradualistes ou saltationnistes, les darwiniens me semblent avoir parfois une conception un peu simple de la biologie, une conception en quelque sorte clés en mains. Pour eux un gène est comme une commande sur le catalogue de La Redoute. L’article de Walter Gehring que vous avez publié sur le supergène qui déclenche la fabrication des yeux de la mouche reflète cette conception. On peut accepter que les gènes fonctionnent ainsi et ne pas se poser de question. Mais si l’on cherche à l’expliquer, alors le darwinisme n’est d’aucun secours…
L.R. : Vous soutenez qu’un gène est conçu comme une commande à La Redoute. Que voulez-vous dire exactement ?
M.-P. S. : Schématiquement un gène est assimilable à une unité d’information. Il est là ou non. Quand il est activé, c’est un ordre élémentaire du type oui-non. Mettez du persil, arrêtez la cuisson… Restons-en à l’exemple de l’œil. On dit qu’il faut mille ou deux mille gènes pour fabriquer un œil. Donc mille à deux mille unités d’information. C’est dérisoire ! Supposons qu’une firme française souhaite faire fabriquer par une usine en Asie du Sud-Est un appareil électroménager entièrement nouveau et que, pour des raisons commerciales, elle ne dise rien de la fonctionnalité de l’appareil, elle ne dise pas comment il marche ni à quoi il doit servir. Avec quelques milliers de bits le fabricant n’ira pas loin. Car c’est l’équivalent d’un paragraphe de ce texte. L’appareil autrement plus simple qu’un œil ne sera convenablement construit que si le fabricant comprend la signification des opérations dont on lui demande d’assurer l’usinage ; c’est-à-dire s’il a déjà l’idée de l’objet avant de le fabriquer. Ce qui représente une masse de connaissances communes au donneur d’ordres et au fabricant autrement considérable.
L.R. : Vous voulez dire que le génome ne contient pas assez d’informations pour expliquer le vivant ?
M.-P. S. : Du moins pas d’après la connaissance que nous en avons. Les prédicats utilisés par les biologistes sont tout à fait insuffisants. Ce n’est pas parce qu’on sait qu’un gène déclenche la fabrication de telle ou telle protéine qu’on comprend comment un ou deux milliers de gènes suffisent à diriger le cours du développement embryonnaire.
L.R. : Vous allez vous faire accuser de préformisme…
M.-P. S. : Et de bien d’autres crimes. Ma position est pourtant strictement rationnelle. Je formule un problème qui me paraît majeur : comment se fait-il qu’avec aussi peu d’instructions élémentaires la matière vivante soit capable de fabriquer des objets aussi merveilleusement compliqués et efficaces ? Cette propriété dont elle est dotée, quelle est sa nature ? Rien dans nos connaissances physico-chimiques actuelles ne permet de l’imaginer. Si l’on se place du point de vue de l’évolution, il faudrait aussi admettre que d’une manière ou d’une autre les poissons de l’ère primaire contenaient en puissance les germes d’organes qu’ils n’avaient pas mais qu’auront leurs successeurs quand ils quitteront les eaux pour la terre ferme et les airs, et avec les câblages neuronaux appropriés.
L.R. : Vous affirmez qu’en fait, le darwinisme n’explique pas grand-chose.
M.-P. S. : Il me semble en effet que le couple mutations-sélection au hasard présente une certaine valeur descriptive, mais en aucun cas explicative. Le darwinisme fait des constats écologiques sur l’abondance relative des espèces et des biotopes. Et la valeur descriptive du modèle est d’ailleurs elle-même limitée. En outre, ce sur quoi insistent les saltationnistes, la thèse gradualiste semble complètement démentie par le progrès des connaissances en paléontologie. Quant aux miracles du saltationnisme, ils ne peuvent que renvoyer à la propriété mystérieuse que j’ai évoquée.
L.R. : Revenons sur la sélection naturelle. N’a-t-elle pas malgré tout une certaine valeur explicative ?
M.-P. S. : Personne ne peut refuser l’existence du phénomène. C’est tout simplement le principe que rien n’existe qui ne soit assez solide pour exister. Sa plus belle application ce sont les lois de Berthollet en chimie élémentaire*. Dans une zone qui se désertifie, les espèces qui disparaissent le plus vite sont celles qui ont le plus besoin d’eau. Ce qui n’explique pas l’apparition chez les survivants de structures dont les propriétés fonctionnelles leur permettent de mieux résister à la sécheresse. Le concept de sélection naturelle n’est pas un concept très fort. Car, sauf dans certains cas artificiels, nos connaissances ne nous permettent pas de prédire que telle ou telle espèce, telle ou telle variété, sera favorisée ou défavorisée en fonction de l’évolution du milieu. Ce que nous pouvons faire c’est constater après coup l’effet de la sélection naturelle. Constater, par exemple, que telle espèce d’escargots est moins mangée que d’autres par certains oiseaux, peut-être parce que leur coquille est moins visible. C’est de l’écologie, très intéressante. Autrement dit, la sélection naturelle est un faible instrument de preuve, parce que les phénomènes de sélection naturelle sont patents, mais ne prouvent rien du point de vue théorique.
L.R. : C’est le couple sélection-mutations au hasard qui compte. N’a-t-il aucune valeur explicative ?
M.-P. S. : Avec la découverte du codage, on a appris qu’un gène est comme un mot composé dans l’alphabet de l’ADN, formant un texte qui est le génome. C’est ce mot qui va dicter à la cellule de fabriquer telle ou telle protéine. Soit une protéine de structure, soit une protéine qui elle-même va en combinaison avec d’autres signaux dire au génome de fabriquer telle autre protéine. Tous les résultats expérimentaux connus se rangent dans ce schéma.
Son application à la théorie de l’évolution donne à peu près ceci : un gène subit une mutation. Étant donné le milieu, cette mutation facilite éventuellement la reproduction des individus qui en sont porteurs, et les mutants ainsi favorisés parviennent progressivement, statistiquement, à remplacer les non-mutants. L’évolution ne serait qu’une accumulation de modifications qu’on me permettra de qualifier de typographiques. Les généticiens des populations étudient mathématiquement la vitesse avec laquelle une mutation favorable se propage dans ces conditions. Ils font ceci avec beaucoup d’habileté, mais ce sont des exercices d’école parce qu’aucun des paramètres qu’ils utilisent ne peut être déterminé empiriquement.
En plus nous retrouvons l’obstacle que j’ai déjà évoqué. Nous savons à peu près combien il y a de gènes dans un être vivant. Environ cent mille chez les vertébrés supérieurs. Ceci semble grossièrement insuffisant pour expliquer l’incroyable quantité d’informations qu’il a fallu pour que s’accomplisse l’évolution.
L.R. : Pouvez-vous donner un exemple concret ?
M.-P. S. : Les darwiniens disent que les chevaux, qui étaient des mammifères gros comme des lapins, ont augmenté leur taille pour s’enfuir plus vite et échapper aux prédateurs. Dans le modèle gradualiste, il faut admettre que l’on puisse isoler ce trait, l’augmentation de la taille, et le considérer comme résultant d’une série de mutations typographiques. Mais ce n’est qu’un effet rhétorique. On impose tacitement au lecteur l’idée que ce qui compte pour un ruminant c’est la vitesse de fuite face au prédateur. C’est peut-être vrai en partie. Mais aucune raison biologique ne permet de déterminer si c’est le critère déterminant. Rien n’interdit de penser non plus que l’augmentation de taille puisse avoir un effet négatif. Les darwiniens me semblent avoir conservé une vision mécaniste de l’évolution, selon laquelle on observerait une succession presque linéaire de causes et d’effets. L’idée aujourd’hui classique en physique que les causes puissent interagir les unes avec les autres me semble avoir une certaine difficulté à percer en biologie. Alors que dans la quasi-totalité des phénomènes observables les modifications locales interagissent de façon dramatique. Il n’y a pas un numéro de La Recherche où sous un prétexte ou un autre il n’y ait un article faisant allusion à l’effet papillon. Or l’informatique est précisément un domaine qui donne une intuition concrète de ces phénomènes. Une modification typographique d’un programme informatique ne change pas un peu le programme, elle l’annule purement et simplement. Il en va de même avec un numéro de téléphone. Si j’essaie d’appeler par téléphone un correspondant, il importe peu que je me trompe sur un, deux trois ou huit chiffres de son numéro.
L.R. : Vous acceptez l’idée qu’une mutation biologique a bien un caractère typographique ?
M.-P. S. : Oui, en ce sens qu’une base est remplacée par une autre, un codon par un autre, mais au niveau de l’activité biochimique qui en résulte on ne peut plus parler de typographie. Il y a toute une grammaire de formation des protéines, en trois dimensions, que l’on connaît encore bien mal. Nous ne disposons d’aucune règle physico-chimique nous permettant de relier de manière intelligible les modifications typographiques à une structure biologiquement efficace. Pour revenir à l’exemple de l’œil, si l’on considère les quelques mille gènes nécessaires à sa fabrication, chacun pris isolément ne signifie rien. Ce qui est signifiant, c’est la combinaison de leurs interactions. Des interactions en cascade, avec des boucles de rétroaction, tout cela exprimant une complexité que nous ne savons pas analyser. Nous pouvons avoir l’espoir de l’analyser mais nous en sommes loin. Gehring constate qu’en changeant tel gène il se produit telle transformation. Il le constate, mais il ne cherche pas à l’expliquer.
L.R. : Mais Dawkins, par exemple, croit à la possibilité d’un processus cumulatif.
M.-P. S. : Dawkins croit en effet à ce qu’il appelle la « sélection cumulative de mutations aléatoires ». Pour étayer sa thèse, il a recours à la métaphore imaginée par le mathématicien Emile Borel : celle du singe tapant au hasard sur un clavier et obtenant finalement un texte littéraire. Métaphore acclamée, hélas !, par Francis Crick, le codécouvreur de la double hélice. Dawkins fait écrire par son ordinateur une suite d’une trentaine de signes, correspondant au nombre de signes contenus dans un vers de Shakespeare. Il procède ensuite à une simulation du mécanisme darwinien, sélection-mutations au hasard. Son singe fictif tape et retape ces mêmes signes, sauf que l’ordinateur choisit chaque fois la phrase qui ressemble le plus, même de très loin, au vers de Shakespeare. Par ce procédé que Dawkins appelle de « sélection cumulative », le singe parvient au but en une quarantaine ou une soixantaine de générations.
L.R. : Or vous ne croyez pas qu’un singe tapant sur un clavier, même aidé par l’ordinateur…
M.-P. S. : Cette démonstration est un trompe-l’œil et Dawkins ne décrit pas exactement comment il procède. Si l’on se livre à l’exercice sur un ordinateur, on constate que les phrases qu’on obtient se rapprochent en effet assez vite de la cible au début. Mais à mesure qu’on s’approche de la cible cela devient de plus en plus long. Des mutations dans la mauvaise direction nous font régresser. En fait, un raisonnement simple montre qu’à moins de choisir habilement les paramètres numériques, la progression devient horriblement lente.
L.R. : Vous voulez dire que le modèle de sélection cumulative imaginé par Dawkins est sans rapport avec une réalité biologique palpable ?
M.-P. S. : Exactement. Le modèle de Dawkins laisse entièrement de côté le triple problème de la complexité, de la fonctionnalité et de leur interaction.
L. R. : Vous êtes mathématicien. Supposons que vous tentiez malgré tout de formaliser ce concept de complexité fonctionnelle…
M.-P. S. : Je ferais sans doute appel à une notion bannie de la communauté scientifique, mais parfaitement comprise par tout un chacun : celle de but. En tant qu’informaticien, on peut la rendre triviale de la façon suivante. On construit un espace adéquat dans lequel l’une des coordonnées va servir de fil d’Ariane pour guider la trajectoire vers le but. C’est une formalisation parfaite. Une fois cet espace construit, le système évolue de façon mécanique vers le but qu’on lui a fixé. Mais il y a une difficulté : c’est que la construction elle-même de cet espace ne peut se faire qu’après une analyse préalable de tous les trajets possibles et de l’estimation de la distance au but à laquelle se trouve la fin de chacun d’eux. Ceci est hors de portée d’une étude empirique. Elle présuppose – j’emploie encore le même mot – que je connaisse déjà la totalité de la situation. Et en termes de logique mathématique la constitution de cet espace est un problème d’un ordre infiniment supérieur au problème posé. Or pourtant la fonctionnalité c’est la réussite dans l’atteinte d’un but. Le truc dans l’exemple apologétique de Dawkins est d’introduire subrepticement cet espace. Son programme informatique de sélection cumulative le réalise de façon tacite en calculant la distance au but, la phrase cible, par le nombre des lettres qui ne sont pas encore en place. Ceci ne correspond en rien à une réalité biologique. La fonction qu’il emploie frappe l’imagination parce qu’elle a une propriété de simplicité qui entraîne l’adhésion naïve. Dans la réalité biologique l’espace dans lequel il faudrait se plonger pour décrire la fonctionnalité la plus simple est d’une complexité qui défie l’entendement et bien sûr tout calcul.
L.R. : Même quand ils se disent darwiniens, les saltationnistes sont plus modestes : ils ne prétendent pas détenir la clef permettant d’expliquer l’évolution…
M.-P. S. : Avant d’évoquer les saltationnistes, tout de même un mot sur le Japonais Mooto Kimura. Il a montré que la plupart des mutations sont neutres, sans effet permettant une sélection. Pour la thèse centrale du darwinisme, c’est gênant…
La thèse saltationniste, renouvelée par Stephen Jay Gould, reprend l’idée de base due à R. Goldschmidt vers 1940 : il se produirait des mutations très intenses, impliquant sans doute des centaines de gènes, et se déroulant rapidement, en moins de mille générations, donc en dessous du seuil de résolution de la paléontologie. Curieusement Gould ne semble pas gêné pour conserver le tandem mutations-sélection au hasard. Le saltationnisme se heurte à deux types de critiques. D’une part les macromutations supposées sont inexplicables dans le cadre de la biologie moléculaire actuelle. D’autre part Gould passe sous silence l’existence de grandes tendances, comme la complexification croissante du système nerveux central. Il considère que le succès d’espèces nouvelles plus sophistiquées, comme les mammifères, est un phénomène contingent. Il n’est pas en mesure de rendre compte d’un sens de l’évolution, ou du moins de l’existence de trajectoires, qui pourtant ne font aucun doute. On en est donc réduit à invoquer deux types de miracles : celui des macromutations et celui des grandes trajectoires de l’évolution…
L.R. : En quel sens employez-vous le mot « miracle » ?
M.-P. S. : Dans un sens purement rationnel, comme d’un événement dont la probabilité est infime à un degré si j’ose dire ultracosmologique. Parlons des macromutations. Pour devenir un bon éléphant, il ne suffit pas tout à coup d’être doté d’une grande trompe. Il faut qu’en même temps un appareil complètement différent, le cervelet, soit modifié pour mettre en place l’ensemble des câblages nécessaires pour que l’éléphant sache se servir de sa trompe. Les macromutations doivent être coordonnées par un système de gènes dès l’embryogenèse. Or si l’on regarde l’histoire de l’évolution, cela nous fait des dizaines et des dizaines de milliers de miracles, dont les saltationnistes ne savent pas mieux rendre compte que les gradualistes.
Quant à la seconde catégorie de miracles, elle tient au fait que certaines de ces macromutations si l’on admet qu’elles ont eu lieu se sont additionnées les unes aux autres dans une direction bien définie, pour constituer les grandes tendances de l’évolution : complication du système nerveux, mais aussi intériorisation des processus reproductifs, apparition des os, de l’oreille, enrichissement des fonctions relationnelles, etc. Toute une série de miracles dont l’accumulation a pour effet d’accroître la complexité des organismes et leur efficacité. De ce point de vue la notion de bricolage avancée par François Jacob est un constat très intéressant. C’est un joli mot d’auteur, mais il ne donne pas l’ombre d’une explication.
L.R. : L’apparition de l’homme est-il un miracle, au sens où vous l’entendez ?
M.-P. S. : Naturellement. Et ici il semble qu’il y ait d’autres voix que la mienne parmi les biologistes contemporains pour mettre en doute l’explication darwinienne qui était à la mode il y a une vingtaine d’années. Gradualistes ou saltationnistes sont tout à fait incapables de donner une explication convaincante de l’émergence quasi simultanée des nombreux systèmes biologiques qui distinguent l’homme des singes supérieurs : la bipédie avec les modifications concomitantes du bassin et sans doute du cervelet, une main beaucoup plus habile, avec des empreintes digitales qui lui confèrent un tact beaucoup plus fin ; les modifications du pharynx permettant la phonation, la modification du système nerveux central notamment au niveau des lobes temporaux, permettant une reconnaissance fine de la parole. Ces appareils sont du point de vue de l’embryogenèse complètement différents les uns des autres. Chacune de ces modifications constitue l’un des dons qu’une famille de singes ayant beaucoup d’ambition pour ses descendants aurait demandé à une bonne fée de leur donner en cadeau à la naissance. Il est très singulier que ces dons se soient développés simultanément, pour le plus grand bénéfice des primates que nous sommes. Certains parlent d’une prédisposition du génome. Mais que recouvrait concrètement cette prédisposition, si elle a existé ? Était-elle déjà présente chez les poissons du précambrien ? La réalité est que nous sommes confrontés à une totale carence conceptuelle.
L.R. : Vous avez évoqué tout à l’heure un autre courant, qui va en gros des cybernéticiens à l’école de Santa Fe, qui fait appel à des notions comme le chaos…
M.-P. S. : Je faisais allusion à une succession de gens fort compétents qui ont su trouver des expressions poétiques et creuses qui n’expliquent rien. C’est l’ordre par le bruit des cybernéticiens, les structures dissipatives d’un Prigogine, le systémisme d’un Varela*, et maintenant le « bord du chaos » de Stuart Kauffman, dont l’inanité sonore va bientôt nous parvenir en France. Ces écoles mettent la complexité à toutes les sauces. Ils évoquent à l’appui de leur démarche des exemples comme certaines réactions chimiques, le dessin d’une côte maritime, les turbulences atmosphériques ou la structure d’une chaîne de montagnes, dont la complexité est certes très grande mais qui repose, au regard du monde vivant, sur un type d’organisation très pauvre, en tout cas non fonctionnelle. Aucun algorithme ne nous permet d’appréhender la complexité du vivant, qui contrairement à tous ces exemples empruntés au monde physico-chimique est de nature fonctionnelle.
L.R. : Doit-on comprendre votre position comme un constat résigné, un appel à plus de modestie ou autre chose encore ?
M.-P. S. : Disons par antiphrase qu’il ne reste plus aux optimistes qu’à entonner le grand hymne du principe anthropique*. Mais ici nous ne sommes plus dans le discours scientifique, quelques savantes que soient les équations dont les fanfares accompagnent son chant. D’autres pratiqueront la suspension du jugement.
Propos recueillis par Olivier Postel-Vinay dans le mensuel n°283 de La Recherche daté de janvier 1996 à la page 87. https://www.larecherche.fr/m-p-schützenberger-les-failles-du-darwinisme.
Note de B&SD :
* Principe anthropique : Voici comment le philosophe analytique chrétien William Lane Craig définit le principe anthropique : « Certains théoriciens ont tenté de soutenir l’hypothèse du hasard en recourant à ce qui est appelé le principe anthropique. Tel que l’ont formulé Barrow et Tipler, le principe anthropique énonce que n’importe quelle propriété de l’univers qui, à première vue, peut apparaître étonnamment improbable ne peut être perçue dans leur véritable perspective qu’une fois que nous avons rendu compte du fait que certaines propriétés ne pourraient pas être observées par nous, puisque nous ne pouvons observer que les propriétés compatibles avec notre propre existence. Ceci implique que nous ne devrions pas être surpris d’observer l’univers comme il est, et que par conséquent aucune explication de son réglage précis ne doit être recherchée » (Craig, William (2012) Foi raisonnable. Vérité chrétienne et apologétique. Villefranche d’Albigeois : Les Editions La Lumière. Collection « Réforme », volume n° 2, p. 233. https://bibleetsciencediffusion.org/index.php/produit/foi-raisonnable-de-william-craig/)